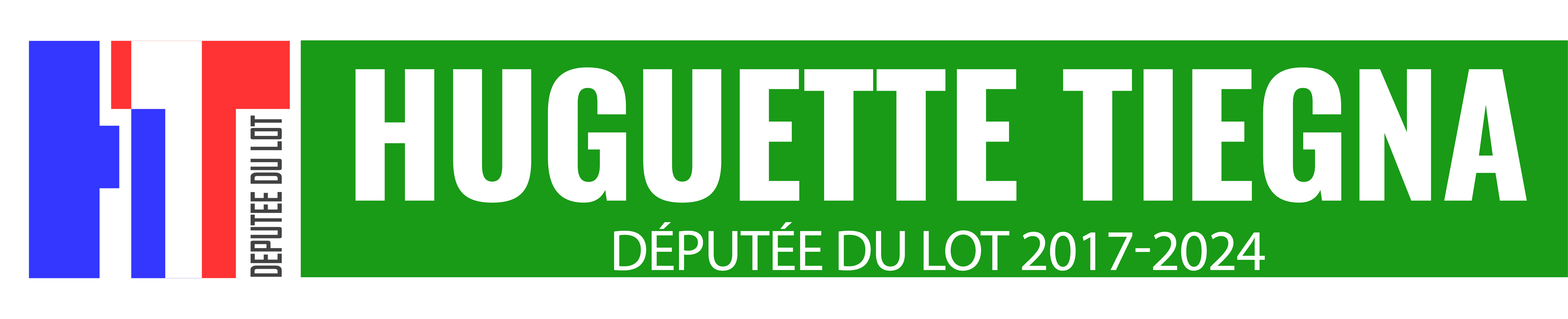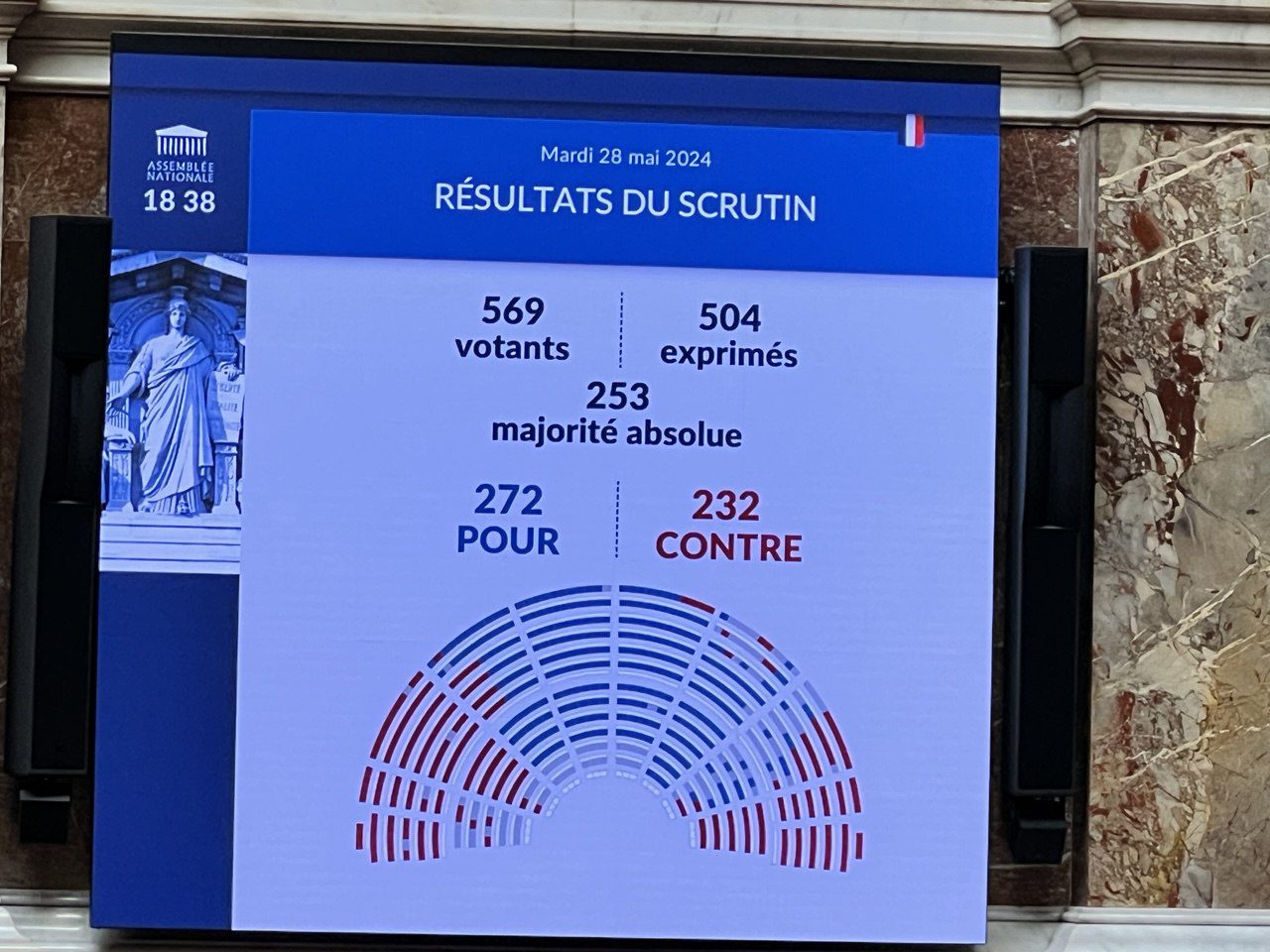Dissolution de l’Assemblée : une réflexion sur notre démocratie
Le 9 juin 2024, la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République a provoqué un véritable tremblement dans le paysage politique français. Ce geste, à la fois audacieux et déroutant, a ouvert la porte à une campagne éclair, marquant la fin brutale du mandat de 577 députés. Mais au-delà de cette tempête institutionnelle, il est essentiel de se rappeler que, dans une démocratie, ce sont les citoyens qui détiennent le véritable pouvoir. Ce sont leurs votes qui façonnent les équilibres, opèrent des choix, et parfois, plongent l’ensemble du système dans l’incertitude.
Nous ne sommes pas de simples observateurs de la scène politique ; nous en sommes les maîtres d’œuvre.
Un droit constitutionnel, un défi politique
La dissolution de l’Assemblée nationale, prévue par l’article 12 de la Constitution, est un outil à la disposition du Président pour réagir face à une situation où l’Assemblée ne parvient plus à soutenir efficacement l’action gouvernementale. Le 9 juin, ce pouvoir a été utilisé dans un contexte de tensions exacerbées et d’une opinion publique désorientée. Le pari était de provoquer un réveil démocratique, de clarifier les rôles, et de rétablir une majorité solide.
Cependant, le résultat a été tout autre : le nouveau Parlement est fragmenté, incertain et souvent en désaccord. Si le Président a agi, ce sont les Français qui ont tranché, et leur verdict a révélé une réalité complexe et divisée.
Le choc pour les élus et le message des urnes
Pour les députés sortants, ce fut un véritable choc. À peine avaient-ils terminé leur dernière réunion de circonscription qu’ils se retrouvaient déjà en campagne. Beaucoup n’ont pas été réélus, et leur engagement, leur travail — parfois acharné, souvent discret — a été balayé en un instant. La décision brutale de dissolution a mis en lumière la précarité de la vie parlementaire.
Mais il est crucial de rappeler que cette décision n’est pas uniquement le fait de l’exécutif ; elle a été validée par les électeurs, dans les urnes. C’est un rappel poignant : dans une démocratie vivante, aucun mandat n’est acquis. Le pouvoir appartient au peuple, et c’est à lui de l’exercer.
Un Parlement reflet d’une société divisée
Le nouvel hémicycle est le miroir d’une société aux multiples facettes, marquée par des tensions et des colères. Les compromis sont difficiles à atteindre, et les majorités sont instables. Faut-il s’en étonner ? Pas vraiment. Ce Parlement est le reflet fidèle de l’état d’esprit des électeurs.
Cependant, cette représentation fidèle ne vient pas sans défis : blocages, lenteurs et instabilités. Voter pour sanctionner sans proposer peut parfois interdire toute possibilité de construction. En démocratie, l’impasse électorale finit par se traduire en impasse politique. Nous ne pouvons pas nourrir le désordre tout en alimentant, scrutin après scrutin, l’impossibilité de gouverner.
Repenser notre rôle en tant que citoyens
La leçon à tirer de cette dissolution transcende le cadre institutionnel. Certes, la question de l’encadrement du pouvoir présidentiel mérite d’être posée. Oui, la réforme de nos institutions est nécessaire. Mais le cœur du problème réside dans notre rapport au vote.
Trop souvent, le vote est considéré comme un réflexe défensif, un acte d’humeur, un simple outil de sanction. Pourtant, il devrait être un acte de construction. Chaque citoyen détient une parcelle de souveraineté, et cette souveraineté implique une responsabilité. Elle exige de nous une information éclairée, une réflexion, un choix. Pas seulement une réaction.
Oui, la démocratie est exigeante. Elle réclame plus que de l’indignation. Elle appelle à une cohérence, à une constance, et à une participation active.
Une démocratie vivante, mais vulnérable
Le 9 juin 2024 a été un moment décisif. Il a révélé la fragilité de nos institutions face aux crises politiques et la volatilité de nos choix collectifs.
Mais surtout, il nous rappelle que la démocratie ne se décrète pas : elle se vit, elle se construit, elle se défend.
Le vote n’est pas un simple bouton d’alerte ; c’est une brique dans l’édifice commun. Il est temps de cesser de croire que le système est extérieur à nous. Nous sommes le système.
Au moment où les certitudes s’effondrent et où les discours simplistes trouvent un écho, notre premier devoir n’est pas de choisir un camp, mais de comprendre notre rôle. La question essentielle n’est pas seulement : « Pour qui vais-je voter ? » mais : « Quelle société désire-je construire, et à quoi suis-je prêt à contribuer pour qu’elle advenienne ? »